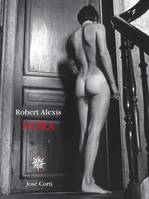-
 Conseillé par Hécate L.1 septembre 2010
Conseillé par Hécate L.1 septembre 2010Nora de Robert Alexis
Avec cette sixième parution aux éditions Corti, Robert Alexis pourrait s’inscrire dans la lignée des romanciers de l’inavouable.
Ce qu’il narre est à la fois un clin d’œil aux « Contes immoraux » du Siècle des Lumières, tout comme aux noires cruautés de ceux du lycanthrope Pétrus Borel où la femme est souvent contrainte et violentée, et pourquoi pas aux vertiges névrotiques d’un Villiers de l’Isle-Adam qui écrivait que « le seul contrôle que nous ayons de la réalité c’est l’idée ».
Une épigraphe de Klossowski sert d’entrée de jeu aux jeux entrelacés des déviances de la sexualité.
« Le Je, plaisanterie grammaticale ».
« Je n’existais plus »
Nora est celle qui écoute « assise jambe croisées au coin d’une table, une main posée en soutien de la tête… »
Supputer une subtile allusion à la Nora de « Maison de poupée », cette héroïne qui a fait voler en éclat le monde du conformisme en affirmant son droit à la liberté, véritable défi qui scandalisa la société d’alors, est assez tentante, d’autant que la structure des contes repose sur des entractes entre les chapitres. Entractes qui permettent l’articulation des décors et des situations.
Nora, peut-être la figure de la compassion ?...
« Les ressorts conjugués du désir, des projets, des souvenirs et du présent s’agitaient sur une lointaine estrade. »
Dans le théâtre du dramaturge norvégien Ibsen les forces négatives de l’être poussent ses personnages à chercher à sortir des normes pour renaître à eux-mêmes, un thème que Robert Alexis aborde plus que jamais avec l’élégance d’une écriture osée. Il use de sa plume en virtuose titillant les fantasmes masochistes à leurs paroxysmes, comme avec son archet Paganini savait tirer d’un violon des stridences excitantes, novatrices et mystérieuses.
« Le nu androgyne » qui illustre la couverture semble avoir le rôle d’introduire le lecteur dans les « Ruines d’Orsanne » titre qui sert de prologue aux contes.
« Brusquement apparu entre deux langues de vapeur le château avait projeté la pâle lumière de ses façade, Nora s’était levée, le visage tendu vers l’étrange éclosion et j’avais à mon tour pu m’étonner d’une féerie de tours crénelées, de toits d’ardoise, de la porte gigantesque terminant une allée de châtaigniers. Un instant seulement ! mais un instant enchanteur, de ceux qu’une gravure propose à l’enfant plongé dans la lecture d’un conte, avant qu’il ne tourne la page, que la brume ne reprenne ses droits sur un monde interdit aux simples mortels ».
Un monde d’interdits multipliés va s’entrouvrir et les scènes vont glisser insensiblement vers les voluptés de l’abyme, les décors n’étant plus que des conventions obéissant aux perspectives de l’inéluctable.
Les lecteurs familiarisés avec les romans de Robert Alexis retrouveront des bribes de similitudes subtiles : le narrateur de « La Véranda » était en proie à de curieuses hallucinations, il achetait soudainement une villa entrevue, ici c’est un château plus isolé ceint d’une forêt de trente hectares aperçu par hasard du haut d’un promontoire naturel.
« Assis sur le banc épargné par l’humidité, nous avions ri devant un panorama de nuages épais… »
C’était sur un banc que l’inquiétant Hermann attendait le jeune officier de « La Robe ».
Faut-il s’étonner de retrouver le banc qui est le titre du premier conte ? Sur un banc on rêve, on perd toute notion du temps. La pensée abandonnée à elle-même n’est plus maîtresse des pulsions dont s’amuse l’identité.
« Déjà, j’imaginais les subterfuges dont sont coutumiers ceux qui agissent en-dehors de la normalité : se munir d’un sac, y placer les vêtements, s’habiller là-bas dans la haie buissonnière derrière le cèdre bleu, et venir s’asseoir sur le banc, et venir se montrer ! »
L’auteur élabore autour du fantasme érotique toutes les déclinaisons de la perversité jusqu’aux abjections les plus absolues.
« Il s’opère dans notre monde mental comme la fissure de l’atome » disait Powys. Robert Alexis nous en fait une démonstration magistrale !
« Je ne crois pas que la nature d’un fantasme soit réellement importante... L’essentiel se situait dans la qualité que l’on pouvait coupler à n’importe quoi ».
Krafft – Ebing, le psychiatre austro-hongrois a été l’un des premiers à noter les observations sur le besoin de s’humilier, voir de se torturer pour accéder au bonheur. Tout comme l’extrême lubricité de certains vieillards…
Un bel exemple de ces vésanies de l’esprit nous est donné ici avec « un tableau qui a eu son heure de gloire au seizième et dix-septième siècle. Une jeune femme, épouse vertueuse d’un riche babylonien est surprise au bain par deux vieillards. Elle est soumise à un choix : accepter de faire l’amour avec eux ou être faussement dénoncée pour avoir donné rendez-vous à un jeune homme caché dans le parc. »
Je défis quiconque ayant lu les pages suivantes de pouvoir regarder ces tableaux d’un même œil ! (Nombreux sont les artistes qui ont abordé ce thème emprunté à l’Ancien Testament, Tintoret, Rembrandt, Van Dyck, Rubens, Jacob Joardens…)
« Une paume enserra mes genoux ; une autre visita l’intérieur de mes cuisses. Un doigt audacieux tira parti de mon abondance, et vainquit sans coup férir la seconde intimité. Je plongeai dans un monde où rien n’existait plus que ce que l’on me faisait… »
« Je restai debout, bras et jambes écartées, livrée aux molles pressions d’une bête tentaculaire ».
« Garçon » aborde les relations équivoques des enfants et des prêtres, échos au roman quasi autobiographique « Garçons » de Montherlant.
« L’abbé s’en prenait particulièrement aux endroits les plus menacés. – Tu vois, il faut montrer qu’on est bien un garçon… »
« Bientôt, je me levai la nuit lorsque j’étais sûr que mon voisin dormait et circulai dans la chambre, d’une place à l’autre, m’allongeant sur le matelas froid des lits inoccupés, allant jusqu’à la fenêtre exposer ma nudité à ceux que j’espérais cachés derrière les arbres de la cour, des êtres grotesques, les gnomes et les sorcières qui abondaient jadis dans mes livres d’images. »
« Le Dahlia noir » (titre éponyme du célèbre auteur américain James Elroy) nous plonge au cœur du crime.
« Ses yeux fous de panique me ravissaient, ses grognements, ses cris étouffés. Quand elle fut totalement nue, je la retournai, ventre contre le sol, je plongeai entre ses reins, creusant par la force un chemin qui ajouta à ses souffrances.
Non, je n’avais jamais eu autant de plaisir… »
Six contes inquiétants où planent l’ombre de la démesure, le fantasme dans tous ses ébats et l’ivresse d’une résurrection Dionysiaque !